Population et peuplement – Régime français – Capsule 3 - Le territoire français en Amérique du Nord
Le territoire de la Nouvelle-France qui sera occupé en
premier, c’est celui des premiers établissements de Québec, Trois-Rivières et
Montréal. Cependant, dans le monde
rural, on utilisera un système pour augmenter la population et surtout organiser
le territoire : le régime seigneurial.
On peut voir encore aujourd’hui les traces de ce système dans
le paysage rural québécois Ce système,
qui vient de France, est aussi un mode d’organisation sociale qui va perdurer,
même après le Régime français La
manière de fonctionner est assez simple.
Ainsi, l’État va remettre à des seigneurs de grands domaines, à la
condition qu’ils les subdivisent en terres plus petites, les censives, et qu’ils les remettent gratuitement à des colons
qui en font la demande. Généralement, les
censives sont des rectangles étroits orientés perpendiculairement au fleuve
St-Laurent ou à un autre cours d’eau, comme la rivière Chaudière ou la rivière
Richelieu. Les terres les plus convoitées
sont évidemment celles qui sont en bordure de l’eau, ce sont les premières à
être occupées pour des raisons pratiques.
En échange d’une terre gratuite, le censitaire doit s’engager à la
mettre en valeur et à accomplir différentes corvées et payer différentes redevances
annuelles au seigneur, comme le cens et
la rente.
Une fois que la première rangée de terres est concédée, un
deuxième rang est ouvert, parallèle au premier.
Pour se rendre du premier au deuxième rang, un chemin était construit,
qu’on appelle la montée. On ouvrait
autant de rangs que le territoire de la seigneurie le permettait. Des terres, que tous les colons pouvaient
utiliser, étaient aussi réservées pour les animaux d’élevage des premiers
colons : c’est la commune. Les
seigneurs, quant à eux, vont vivre sur
une terre qu’ils se réservent et vont y construire un manoir seigneurial. Aux débuts de la colonisation, il est à peine
plus confortable que les humbles habitations des colons, ce qui sera moins vrai
à la fin du régime français. Près du manoir
seigneurial se construira une église. On lui réserve une place de choix dans la
seigneurie et des terres à proximité lui sont réservées, pour le cimetière et
le presbytère ; ce sont les terres de la fabrique. Généralement, c’est près de l’église que se
développera plus tard le village. S’ajoute
finalement le moulin banal que le seigneur devra construire pour que ses colons
puissent moudre leurs grains, en échange d’une partie de la farine produite.
En 1663, les seigneuries seront de taille inégale et
dispersées entre Montréal et Québec. Le
Canada, nom qu’on donne à la vallée du St-Laurent à l’époque, est peu peuplé et
cela a une incidence sur l’occupation de son territoire : on trouve peu de
villages, si ce n’est la population de Québec, Montréal et Trois-Rivières. Il faut faire la distinction entre le
territoire occupé par la Nouvelle-France et le territoire possédé, puisque la
population ne va pas nécessairement s’établir dans tout le territoire
possédé. Le territoire dont la Nouvelle-France
revendique la possession, en 1663, comprend notamment la vallée du St-Laurent,
l’Acadie, ainsi que la partie connue des Grands Lacs.
Différents voyages faits par les explorateurs vont agrandir le
territoire de la colonie pour l’amener à son apogée, à la fin du 17e siècle. Cependant, cette extension maximale sera de
courte durée puisqu’en 1713, à la suite d’une guerre contre la Grande-Bretagne,
la France a perdu plusieurs territoires avec le traité d’Utrecht. À ce moment, la Nouvelle-France s’étend du
Labrador jusqu’en Louisiane, en passant par le Mississipi. Elle perd définitivement Terre-Neuve, le
territoire de la Baie d’Hudson et la partie de l’Acadie qui deviendra la
Nouvelle-Écosse. La population, quant à
elle, continue toujours de vivre essentiellement dans la vallée du St-Laurent,
qui va toutefois être plus densément occupée, suite à l’augmentation de la
population connue depuis que l’État a pris des mesures en ce sens, avec Jean
Talon.
Population et peuplement – Régime français – Capsule 3 - Le territoire français en Amérique du Nord
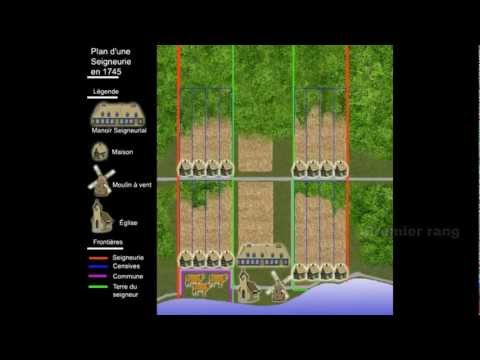 Reviewed by Jimmy Grenier
on
08 janvier
Rating:
Reviewed by Jimmy Grenier
on
08 janvier
Rating:
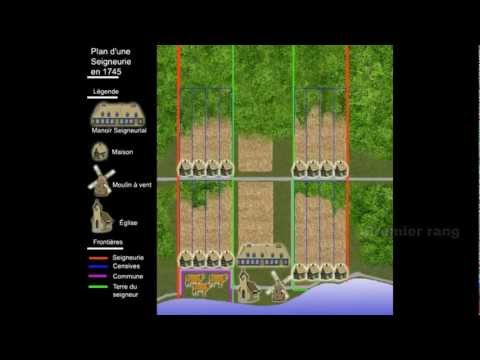 Reviewed by Jimmy Grenier
on
08 janvier
Rating:
Reviewed by Jimmy Grenier
on
08 janvier
Rating:


merci beaucoup! vous me donnez la chance de m'améliorer en histoire, cette matière que je déteste car je ne retient rien...
RépondreEffacerBonne étude! Le but n'est pas de tout retenir mais de mieux comprendre! :)
Effacer