Économie et développement - Régime français - Capsule 2 - L’économie des fourrures
Capsule 2 : L’économie des fourrures
On en a déjà parlé souvent, mais le commerce des fourrures
demeure pendant tout le régime français une activité économique
importante. On n’a pas choisi le castor pour rien sur les
pièces de cinq cent! Si Pierre de Chauvin a fondé Tadoussac en 1600,
c’était pour commercer avec les Montagnais qui vivaient à proximité. On
peut dire la même chose de l’Acadie de Pierre du Gua de Mons, du Québec de
Champlain, de Trois-Rivières de Laviolette et même Montréal, fondé à l’origine
pour des raisons religieuses, mais deviendra rapidement une plaque
tournante du commerce des fourrures. Être proche des Grands lacs a son
utilité! Pour illustrer l’importance du commerce des fourrures, disons
qu’on a exporté vers la France - pour la seule année 1699 - près de
300 000 peaux de castor! Ça fait des pelleteries le principal
produit d’exportation de toute l’histoire de la Nouvelle-France.
Pour mener à bien le commerce des fourrures, les Français devront
tisser des alliances avec différents groupes autochtones, comme les
Montagnais, les Algonquins et les Hurons. C’est d’autant plus nécessaire
que le gros de l’ouvrage est fait par les Amérindiens! En fait, ce sont
eux qui vont à la chasse et qui préparent les peaux. Certains Amérindiens
vont même porter les fourrures pendant quelque temps pour leur donner plus de
valeur. Puisqu’on fabriquait des chapeaux avec les peaux, la sueur
engendrée par le port des fourrures donnait un feutre de meilleure qualité et
les Amérindiens pouvaient espérer obtenir un meilleur prix.
Un autre personnage important dans le commerce des fourrures
est le coureur des bois. Il sert d’intermédiaire entre les compagnies et
les autochtones. Peu appréciés des autorités, surtout les autorités qui
les trouvent trop indépendants, ils sont comme des travailleurs autonomes qui
travaillent pour leur propre gain. Pour ce faire, ils parcourent de
longues distances pour s’approvisionner en fourrures en apportant avec des
produits de comme des outils en métal, des couvertures en laine, des armes à
feu ou de l’eau de vie pour les échanger contre des peaux aux
Amérindiens. Quand des mesures en vue de peupler la colonie seront mises
en place par les autorités dans la deuxième moitié du 17e siècle, il faudra
même obtenir un permis spécial pour faire la traite des fourrures. On
parlera à partir de ce moment-là de « voyageurs » pour les désigner,
ce qui les distinguent des coureurs des bois qui eux, n’ont pas de
permis.
Les distances, quant à elles, deviendront de plus en plus
grandes puisqu’il faudra toujours aller plus loin satisfaire l’appétit des
marchands impliqués dans le commerce des fourrures. Si la Nouvelle-France
de 1645 se résume grosso modo à Québec, Montréal et Trois Rivières, elle
représentera siècle plus tard un immense territoire qui s’étend du Labrador à
la Louisiane, en passant par la vallée du St-Laurent, l’Acadie, le Mississipi
et les Pays d’en Haut. Le territoire sera composé en majeure partie de
forts et postes de traite, une occupation qui est reliée directement au
commerce des fourrures. On dira cependant que la Nouvelle-France est un
géant au pied d’argile ; son peuplement très faible ne dépassera jamais
70 000 habitants, essentiellement vivant dans la vallée du
St-Laurent. Les premières compagnies, qui étaient responsables du peuplement
de la colonie, ne réussiront jamais à remplir leurs promesses quant au
peuplement ; un retard que la Nouvelle-France ne rattrapera jamais.
Une telle occupation du territoire attise les convoitises ;
déjà, au début du régime français, Anglais, Français et Hollandais se sont
disputés le contrôle du commerce des fourrures avec les Iroquois dans ce qui
est aujourd’hui l’État de New York. Plus tard, en 1670, les britanniques
fondent la Hudson Bay Company et revendiquent le territoire du même nom pour concurrencer
la Nouvelle-France et ses fourrures. De plus, les colonies anglaises
voient leur population dépasser rapidement le million et se sentent de plus en
plus coincées et voudraient bien prendre de l’expansion plus à l’ouest, dans la
vallée de l’Ohio – et en même temps prendre le contrôle du commerce des
fourrures.
Économie et développement - Régime français - Capsule 2 - L’économie des fourrures
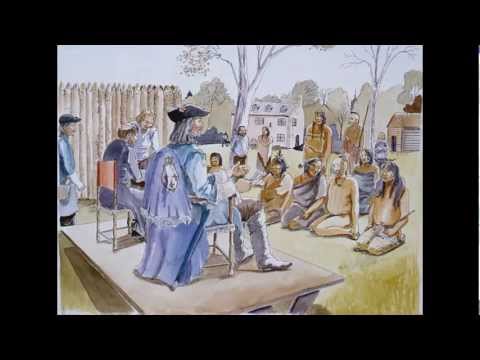 Reviewed by Jimmy Grenier
on
22 décembre
Rating:
Reviewed by Jimmy Grenier
on
22 décembre
Rating:
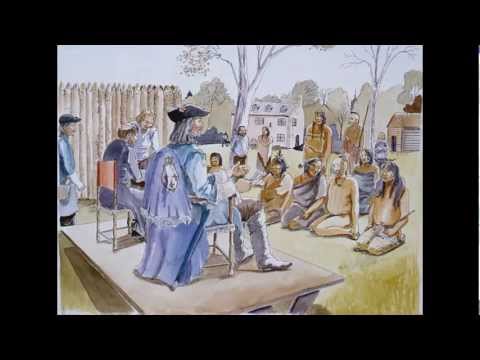 Reviewed by Jimmy Grenier
on
22 décembre
Rating:
Reviewed by Jimmy Grenier
on
22 décembre
Rating:


Aucun commentaire